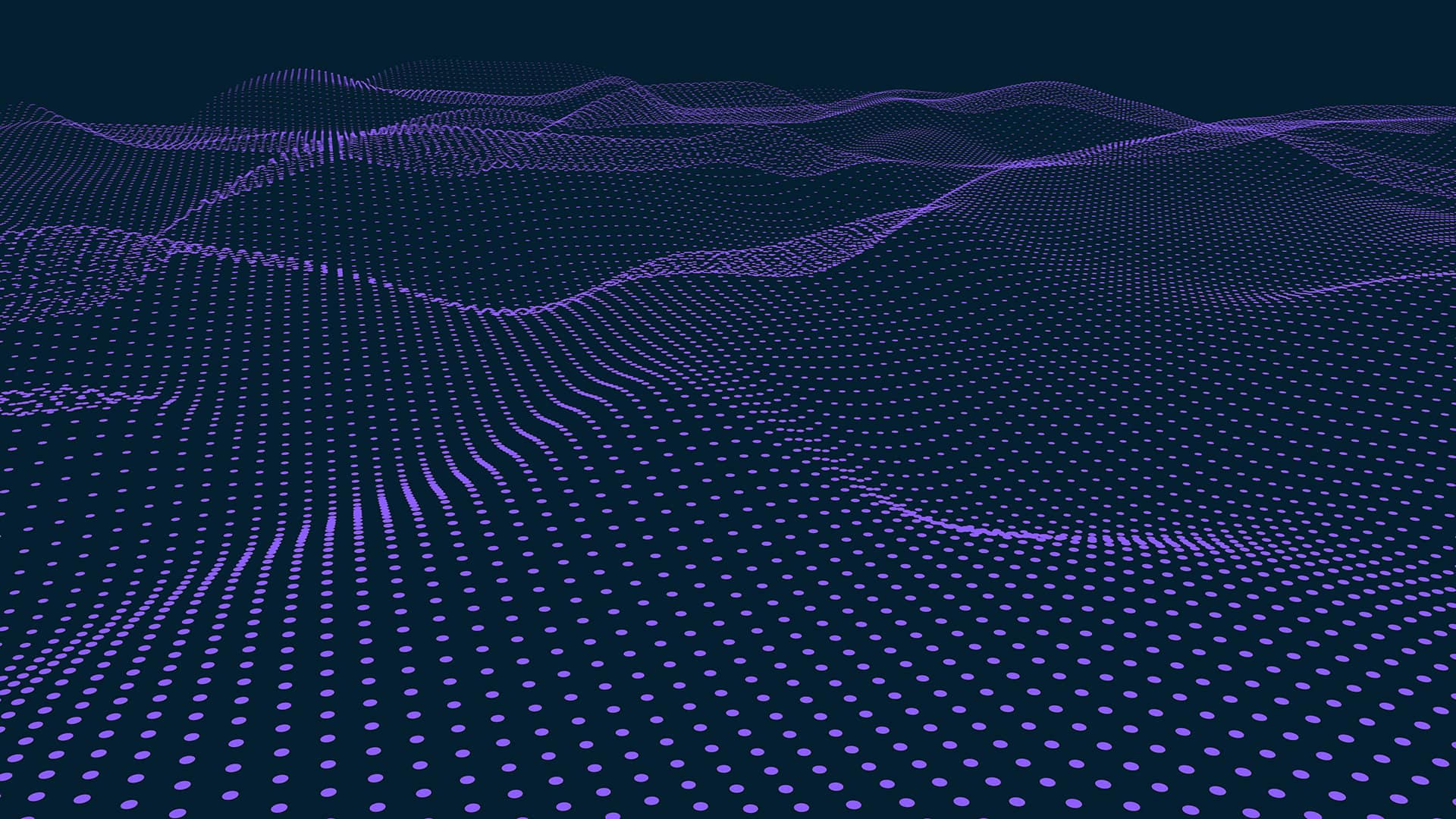« Penser l’avenir, c’est prévoir l’imprévisible »
Publié le Modifié le
La crise sanitaire liée au Covid-19 a déjà eu et aura, à long terme, des conséquences inéluctables sur notre société, et sur nos façons de vivre et d’anticiper les risques. Comment se réinventer et tirer les leçons de cet événement – presque – sans précédent ? Retour sur les réflexions liées au « monde d’après » avec Michel Wieviorka, sociologue, président de la Fondation maison des sciences de l’Homme, et directeur d’études à l’Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS).
Temps de lecture : 5 minutes (en moyenne)

L’épidémie de Covid-19 a ouvert une réflexion sur le monde « d’après ». Êtes‑vous dans le camp des optimistes ou dans celui des pessimistes ?
Ceux qui ont annoncé une rupture anthropologique sont allés beaucoup trop vite en besogne. Mais il en va de même pour ceux qui ont prédit que la situation serait la même qu’avant, éventuellement en pire. La vérité est entre les deux. La pandémie a fait davantage que révéler les évolutions de la société française, elle les a accélérées et accentuées. La crise que nous venons de vivre a fait apparaître au grand jour les tensions entre le besoin de sécurité et d’autres préoccupations tout aussi légitimes.
Quel genre de tensions ?
Le virus a conduit à des mesures d’exception parfois au-delà du raisonnable.
Liberticide, le confinement qui devait nous protéger est apparu en contradiction avec les droits de l’Homme. La tension a aussi pris un aspect économique. La sécurité absolue était de rester chez soi, ce qui allait à l’encontre de l’idée de produire et d’échanger. Troisième exemple, la crainte de l’autre pour des raisons sanitaires, incompatible avec le désir d’accueillir autrui et de se déplacer sur tous les continents.
Comment allons-nous pouvoir résoudre ces tensions ?
Nous allons être amenés à réfléchir au niveau de chaque entreprise, de chaque communauté, de chaque institution, à la position du curseur de sécurité.
Voyez-vous déjà une tendance claire se dessiner ?
Cette expérience marque notre basculement massif dans l’ère numérique, esquissé il y a déjà un bon quart de siècle. Nos vies personnelle et professionnelle ont été bouleversées par Internet et les réseaux sociaux. Nous allons devoir nous interroger sur les aspects positifs, et négatifs, de cette évolution, qui ne va pas nécessairement se révéler être un progrès. La fracture numérique au sein de la société est bien réelle. Le télétravail ne permet plus aux gens de se croiser dans les couloirs ou de se rencontrer près de la machine à café. Il pourrait casser les communautés de travail.
Je vois dans l’expérience du confinement un risque de repli qui va peser sur la notion de travail et sur l’organisation de l’espace, public et privé. Si je travaille à mon domicile, est-ce à moi de payer l’emplacement de mon bureau et la facture de la Wifi ou de l’électricité qui permettent à mon ordinateur de fonctionner ? De nouvelles questions surgissent.
Les réseaux sociaux représentent-ils un risque ?
Ils présentent des aspects positifs, permettant à chacun de communiquer, en temps réel, d’être en interaction avec d’autres, à une échelle éventuellement planétaire, de se mobiliser. Et des aspects négatifs, puisqu’ils peuvent véhiculer la haine, le mensonge, les appels la violence, le racisme, l’antisémitisme, etc.
On parle d’un rôle à reconquérir pour l’Etat. Qu’en pensez-vous ?
La conception même de l’Etat a été mise en cause par le coronavirus. Je vois venir une demande d’intervention plus forte, de protection ou de redistribution sociales, mais nous ne sommes pas encore allés très loin dans la réflexion sur les erreurs du passé, sur la désindustrialisation notamment.
Nous n’aurions rien appris des crises sanitaires antérieures ?
Dans les années 1950 et 1960, nous avons connu la grippe asiatique, puis deux vagues de grippe dite « de Hong-Kong ». Ces événements sont sortis de la mémoire des Français. En revanche, nous n’oublierons pas le coronavirus car, ainsi que l’analysait le sociologue allemand Ulrich Beck avec son concept de « société du risque », nous comprenons mieux qu’un événement très peu probable, imprévisible dans son contenu et dans notre façon de l’aborder, peut avoir un effet considérable sur l’humanité, ou en tous cas sur notre société. Que l’avenir n’est pas la simple continuité du présent. Penser l’avenir c’est prévoir l’imprévisible.
Est-ce un échec du fameux principe de précaution ?
Ce principe n’était pas en vogue au moment de l’accident de Tchernobyl, à l’époque du scandale du sang contaminé et de la propagation du sida, ni même lors des canicules meurtrières. À chaque fois, on a vu que la prise de précaution absolue s’est imposée, mais avec une conséquence catastrophique : personne ne veut prendre de risque, tout le monde a peur de devoir prendre des responsabilités.
Notre rapport à l’insécurité va-t-il changer ?
Dans les années 1970 et 1980, l’insécurité était sociale. Elle est devenue géopolitique avec la montée du terrorisme. Puis technique, avec les attaques informatiques. Et voilà que brusquement, elle prend une dimension nouvelle, un mélange d’éléments naturels (le virus) et humains (la gestion de la crise sanitaire). Nous sommes dans une nouvelle ambivalence.
Le bonheur est-il moins à portée de main désormais ?
Avant le Covid-19, nous vivions davantage dans le présent. Beaucoup disaient : je vais bien, mais la France va mal. Ou bien : mes enfants auront une vie plus dure que la mienne. Aujourd’hui, nous rentrons dans l’histoire, sur un mode tragique, à cause d’un phénomène assez largement naturel qui nous pousse à penser à la construction de l’avenir. Cela me fait penser aux « jours meilleurs » qu’invoquait le Conseil national de la résistance pendant la guerre. Je rêve du retour des lendemains qui chantent ! Même si je sais bien que les années d’après-guerre ont été très dures.