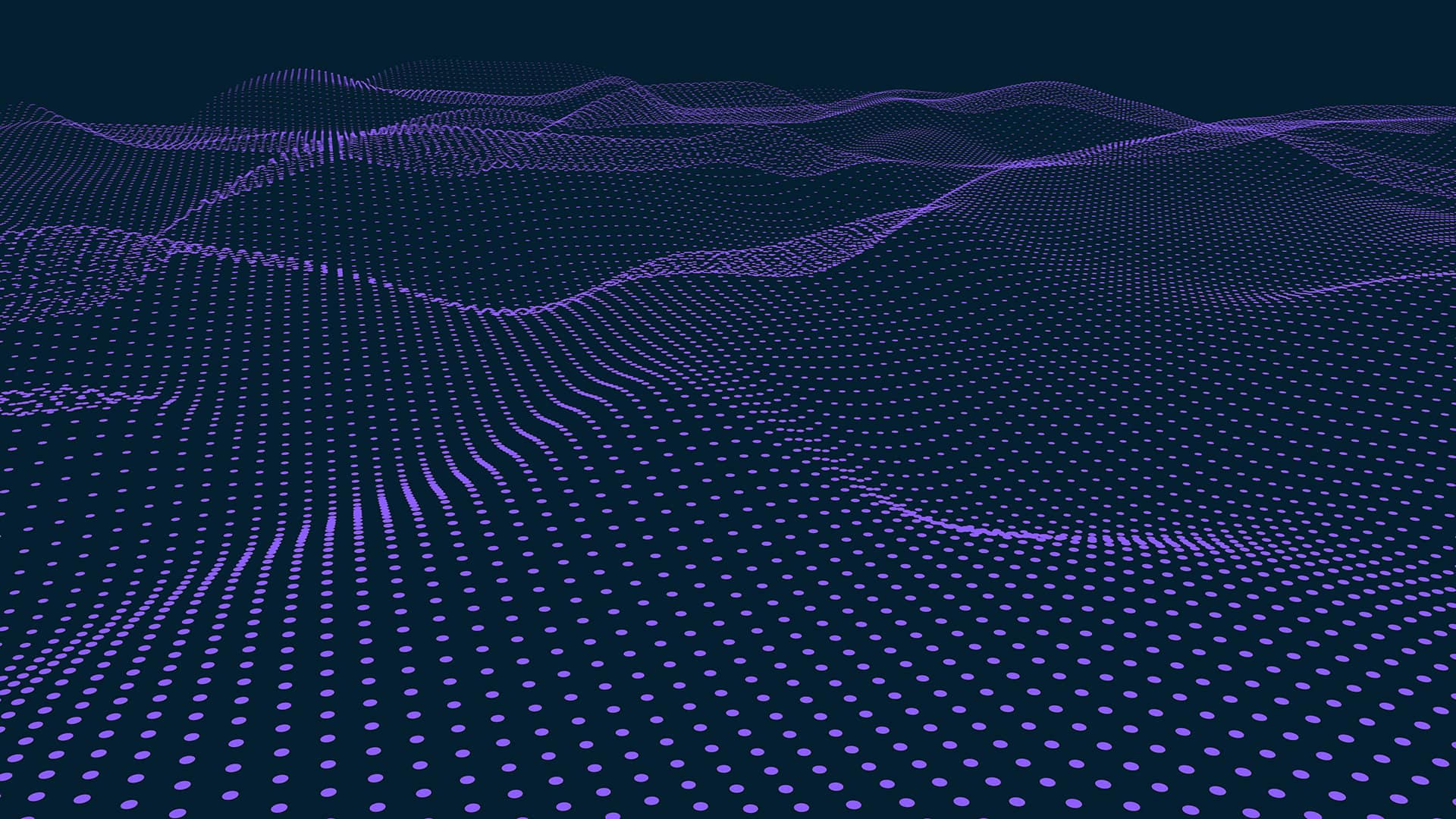« La sécurité n’est jamais gratuite »
Publié le Modifié le
La psychologie peut nous enseigner beaucoup de choses sur la perception du risque et le comportement des populations. Nous avons demandé à Jean-Pascal Assailly, psychologue, chercheur à l'université Gustave-Eiffel de Champs-sur-Marne, en région parisienne, si les choses avaient changé sur la période récente, avec la pandémie de Covid-19 et maintenant la guerre en Ukraine.
Temps de lecture : 6 minutes (en moyenne)

D’un point de vue historique, comment l’approche du risque a-t-elle évolué dans le temps chez les humains ?
Jean-Pascal Assailly : Il est très compliqué de dégager des tendances, car les outils de mesure évoluent et les populations ne sont pas comparables d’un siècle à l’autre. Toutefois, on attribue une rupture au tremblement de terre qui a ravagé Lisbonne en 1755 et aux commentaires qu’a pu en faire Voltaire à l’époque. Jusqu’aux Lumières, le risque était perçu comme quelque chose de divin et fataliste. C’est Dieu qui décidait. Mais à Lisbonne, les survivants se sont dit que Dieu n’avait pas pu vouloir un tel carnage. Voltaire a alors posé l’idée qu’il fallait trouver une autre cause et l’on est entré dans la conception laïque du risque.
Le fatalisme a-t-il complètement disparu ?
J.-P. A. : Il est toujours prégnant dans les sociétés où le religieux est important, en Afrique et en Asie surtout. Dans l’islam, encore aujourd’hui, quand on parle de prévention en matière de santé ou d’accident de la route, on s’entend souvent répondre « mektoub » : ce qui doit arriver arrivera, il est inutile de vouloir contrer le destin. On est loin de la vision scientifique du risque et de la notion de hasard qui prévalent en Occident.
La révolution industrielle a-t-elle changé le sens même du risque ?
J.-P. A. : Au XXe siècle est arrivée l’idée que ce sont les humains eux-mêmes qui fabriquent le risque. La source n’est plus la nature mais la technologie, les pesticides, le médicament… Le risque devient intrinsèque à la science. Ainsi, en inventant l’énergie nucléaire, on s’est rendu capable de produire de l’électricité pas chère mais aussi la bombe d’Hiroshima.
Cela a-t-il conduit à l’abandon de la dimension psychologique du risque ?
J.-P. A. : Au contraire, on se rend compte que l’humain peut être irrationnel et prendre des décisions qui lui feront plus perdre que gagner. L’illustration de cela, c’est l’optimisme comparatif, une constante de l’humanité : je pense que le cancer ou l’accident de la route a plus de chance de tomber sur la tête de mon voisin que sur la mienne. Quand on se regarde dans le miroir, on se croit dix fois plus protégé qu’on ne l’est.
N’est-ce pas le propre des seuls optimistes ?
J.-P. A. : C’est un mécanisme de défense parmi d’autres contre l’anxiété. L’être humain ne peut pas vivre longtemps dans l’angoisse, alors il déclenche des mécanismes pour s’en affranchir, grâce au déni ou à la décrédibilisation de la source.
Justement, la perception du risque n’est-elle pas en train de s’affaiblir avec la multiplication des mouvements complotistes ?
J.-P. A. : Ce qui est sûr, c’est que les réseaux sociaux sont catastrophiques. Ils nourrissent la désinformation de la population et déclenchent des drames cognitifs. La question est de savoir comment lutter contre ce phénomène, et cela devient un sujet politique.
Quel est l’impact du Covid-19 et de la guerre actuelle en Ukraine sur notre appréhension du risque ?
J.-P. A. : Il est un peu tôt pour le dire. La pandémie a confirmé que la perception du risque était une affaire individuelle : certains étaient sûrs de contracter la maladie tandis que d’autres étaient persuadés qu’ils ne l’attraperaient jamais. C’est un peu la même chose avec la guerre : certains croient qu’un troisième conflit mondial et nucléaire est inévitable, d’autres que cette affaire se terminera rapidement. Dans les deux cas, la psychologie clinique aide à analyser les comportements.
C’est à dire ?
J.-P. A. : La psychologie générale va essayer de trouver des points communs entre les individus, malgré leur singularité. Nous sommes tous dotés d’un cerveau d’Homo Sapiens, pas d’une cervelle de baleine. Quand nous traversons une rue, nous regardons à gauche, à droite, avant de prendre la décision de traverser en s’estimant en sécurité. Les opérations cognitives sont assez semblables entre nous. La psychologie différentielle, elle, s’intéresse à ce qui diffère entre les individus : homme et femme, jeune et vieux, fort chercheur de sensation ou au contraire faible chercheur de sensation…
Comment analyser l’attitude de tel ou tel individu ?
J.-P. A. : Quand on entre dans les différences interindividuelles pour comprendre le comportement face au risque, il faut faire appel à la psychanalyse. En effet, l’unité de recherche étant l’individu, il faut comprendre ce qui s’est passé à sa naissance, durant son enfance, quels rapports il a eu avec ses parents etc. Tout cela détermine l’attitude de l’adulte.
Peut-on mesurer le risque mathématiquement ?
J.-P. A. : C’est difficile ! Il existe une équation définissant le risque comme le produit de la probabilité et de la gravité. Or le premier élément, la probabilité, est une évaluation subjective qui dépend de chaque individu. Le second élément, la gravité, correspond à la différence entre le bénéfice et le coût que l’on retire d’une action. Si je suis en retard, j’ai intérêt à traverser très vite la rue. C’est le bénéfice. Si je suis percuté par une voiture, c’est le coût. La prise de risque est fonction du niveau de prudence de chacun et la sécurité n’est jamais gratuite.
Au goût du risque s’ajoute le coût du risque ?
J.-P. A. : Si je roule à 80 km/h sur une départementale, je sais que je ne serai pas flashé par un radar et que je n’aurai pas de PV. Mais je vais arriver en retard au bureau. La question est donc d’évaluer le coût du respect de la loi. Même chose pour une mère de famille assise à l’avant, sur le siège passager, et qui n’attache pas sa ceinture pour pouvoir se retourner et parler à son enfant installé à l’arrière. La prudence n’est pas un concept aussi simple qu’on le croit.
On reproche souvent à notre époque d’être obsédée par le principe de précaution. Qu’en pensez-vous ?
J.-P. A. : Comparé à il y a une trentaine d’années, il est très clair que le monde des entreprises est beaucoup plus sensible au risque. Ce qui compte, c’est le rapport entre court et long terme. Si j’arrête de fumer demain, je vais perdre immédiatement les effets psychoactifs induits par la cigarette dans mon cerveau, pour un bénéfice sur ma santé dans vingt ans. Je peux me dire que je préfère m’en remettre au destin. Et je reviens dans ce cas à la conception pré-Voltairienne du risque.